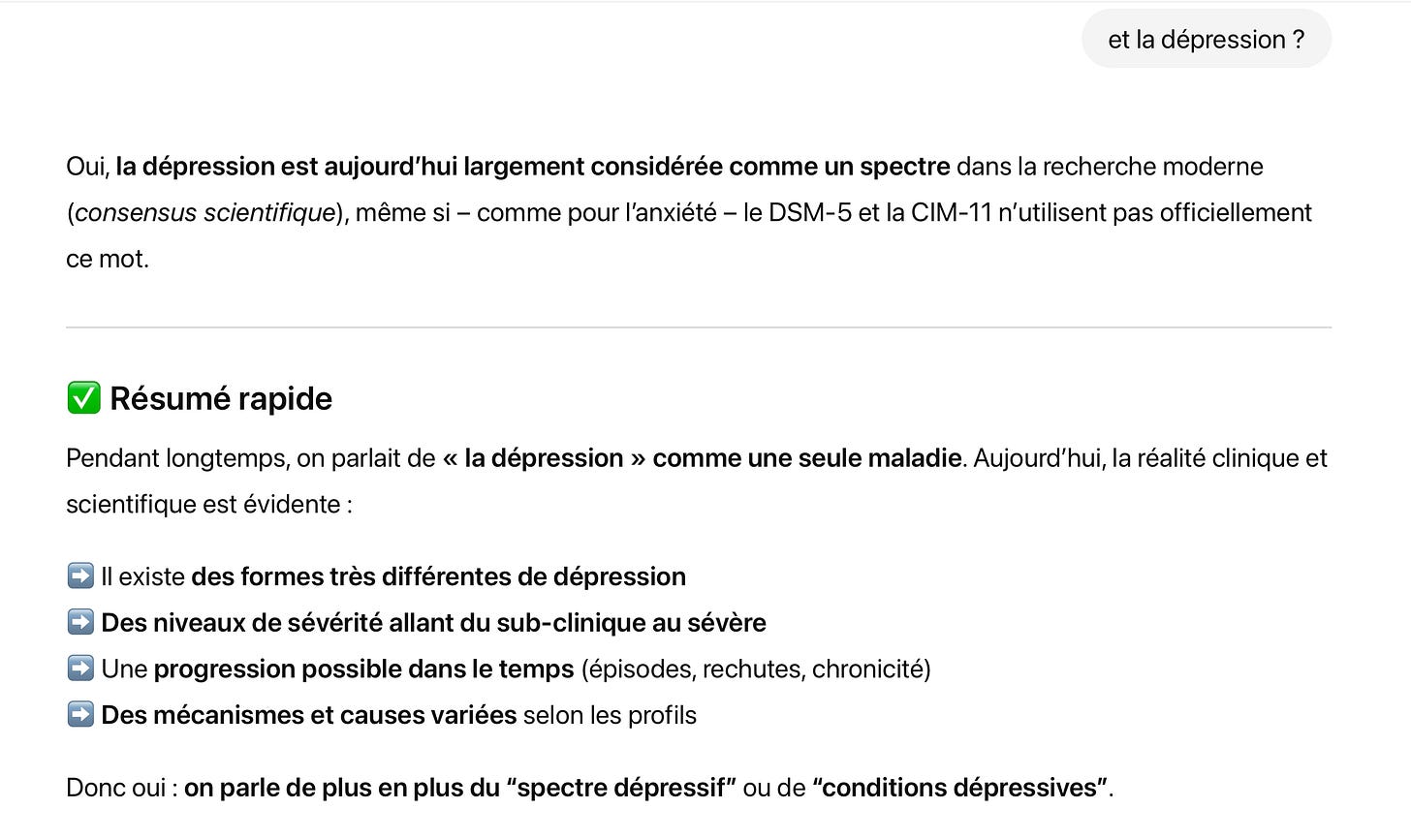Les 5 livres à lire sur l'autisme
Ceux qui m'ont mis d'énormes claques.
C’est, de très loin, la vidéo que j’aurais voulu regarder y’a un an.
Le niveau des livres sur l’autisme est tellement hétérogène que c’est dur de se repérer.
Enfin… en anglais.
En français le niveau est assez homogène puisque 99% de la production est à jeter à la poubelle.
Mais y’a quand même deux exceptions.
1 - Is this autism ? A guide for clinicians and everyone else - Donna Henderson, Sarah Wayland, Jamell White
S’il ne devait en rester qu’un ce serait celui-ci. C’est LE livre qui m’a permis de vraiment comprendre l’autisme.
Il commence par une colère contre l’état de la formation des psys.
Et c’est pas en France, donc imagine en France dans le pays condamné par le conseil de l’Europe pour son retard sur l’autisme.
Avec notamment 86% des soignant·es qui reconnaissent en privé avoir trop peu de connaissances sur l’autisme.
Mais surtout ce qui m’a frappé dans ce livre c’est qu’elles proposent enfin une définition claire.
Y’a un truc qui me frustre dans le contenu sur l’autisme c’est la phrase : quand t’as vu un·e autiste, t’as vu un·e autiste.
Dans le sens où l’autisme peut se manifester de manières très différentes.
Quel aveu d’échec !
La dépression aussi se manifeste de manière différente. Y’a des gens chez qui ça coupe l’appétit, d’autre chez qui ça le décuple : littéralement des effets opposés. Et pourtant personne ne dit que la dépression est un spectre et donc on peut pas dire une vérité générale.
Parce que, techniquement, toutes les catégories du DSM sont des spectres :
Mais y’a que sur l’autisme où on a ce défaitisme de on abandonne de décrire le tronc commun. Y’a plein de raisons à ça et ça part de bonnes intentions (notamment refuser la division artificielles entre autiste de haut et bas niveau).
Mais c’est une impasse.
Si je veux savoir si je suis autiste ce qui m’intéresse c’est justement le tronc commun, pas les différences.
C’est exactement ce que propose ce livre. Comme le dit Annie Kotowicz dans la préface :
Tu pourrais passer des années à déduire les points communs dans les témoignages personnels de manifestation de l’autisme ou tu peux lire ce livre
La plus grand claque que j’ai prise à la lecture c’est sur le critère B2 du DSM. J’étais persuadé que c’était LE critère que j’avais pas (ou peu). Parce que tout le monde appelle ça “routine”.
Or, je ne me reconnais pas du tout dans le concept de routine.
Dans la réécriture de Is this autism, ça donne : psychorigidité.
Et là je me reconnais beaucoup plus. C’est vrai que j’ai des îlots de psychorigidité dans ma personnalité. Pas des routines mais bien des bouts d’inflexibilité. Par exemple je déteste qu’on joue à un jeu sans lire la notice des règles avant, ou alors je réagis très mal quand j’ai l’impression qu’une promesse est enfreinte.
Autre point important du livre c’est de combattre cette fâcheuse tendance que les psys ont d’écarter l’autisme à partir d’un seul comportement.
L’autisme ne peut pas et ne doit pas être écarté uniquement parce qu’une personne présente certains comportements considérés comme « non autistiques ».
Selon notre expérience, de nombreux cliniciens pourtant bien formés non seulement passent à côté de traits autistiques moins évidents, mais ils excluent aussi parfois à tort l’autisme lorsqu’ils observent ce qu’ils estiment être des caractéristiques ou comportements « non autistiques ».
Un nombre incalculable d’autistes se sont vu refuser un diagnostic parce qu’ils établissent un contact visuel typique, utilisent des formules de politesse de base, ont des amis, sont socialement engageants ou apprécient le sarcasme.
Nous avons également rencontré des cliniciens qui écartent l’autisme simplement parce qu’une personne est mariée et heureuse, qu’elle est un parent aimant ou qu’elle réussit dans son domaine. Aucun de ces éléments ne constitue une raison valable d’écarter l’autisme.
Elles rappellent surtout qu’un cabinet est la pire configuration pour évaluer l’autisme. En effet, la personne arrive dans un environnement extrêmement cadré et pourra donner le change, quand bien même elle n’y arriverait pas dans un environnement genre soirée d’appartement.
2 - What I mean when I say I’m autistic : Unpuzzling a life on the autistic spectrum - Annie Kotowicz
Avant le précédent c’était le livre que je recommandais tout le temps.
Parce que c’est la seule bio d’autiste que j’ai lue qui fait un véritable effort de généraliser ses traits. Bien sûr, c’est possible de ne pas se reconnaître, mais c’est plus rare.
Alors que, quasiment toutes les personnes à qui j’ai fait lire la différence invisible m’ont répondu que c’était cool mais que c’était pas elle, avec ce livre c’est l’inverse.
Ce n’est pas un 100%, ça reste un récit particulier. D’ailleurs j’ai été dénicher le livre Is this autism parce que j’avais fait lire What I mean whey I say I’m autistic à quelqu’un qui m’avait répondu bof, je me reconnais pas.
Mais c’est, de loin, le récit qui a le plus haut taux de probabilité de reconnaissance.
L’autre point fort de ce livre c’est qu’il est très court (une centaine de pages). Sachant qu’énormément d’autistes sont aussi TDAH, c’est appréciable.
Je ne sais pas combien de fois j’ai copié-collé ce passage du livre à quelqu’un :
Si tu t’identifies comme autiste, les gens peuvent en douter parce que « tu n’as pas l’air autiste ». Si tu t’identifies comme autiste et que tu prends le temps d’expliquer pourquoi, les gens peuvent en douter parce que tu n’as pas l’aval de l’institution médicale.
Si tu es officiellement diagnostiqué·e, et que cela s’est fait rapidement, les gens peuvent en douter parce qu’ils pensent que le processus n’a pas été assez rigoureux — et qu’aujourd’hui il est devenu trop facile d’obtenir un diagnostic. Si tu es officiellement diagnostiqué·e après un parcours ardu et complexe, avec du sang, de la sueur, des larmes, de la paperasse, en impliquant ton médecin, ta famille, et parfois ton école — même là, les gens peuvent encore en douter.
À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut renoncer à se justifier encore, parce que la cible ne cesse de bouger. Si tu trouves du réconfort et de la joie dans les mêmes choses qui apportent réconfort et joie aux personnes autistes, alors personne ne peut te l’enlever.
De plus, les critères diagnostiques de l’autisme reposent sur une liste de comportements observables. Mais plus j’ai appris sur ces traits apparemment disparates, plus j’ai compris que ce qui fait de moi une personne autiste, ce ne sont pas mes actions extérieures, mais la neurologie intérieure qui les produit.
Mais le passage qui m’a le plus marqué à titre personnel c’est celui où elle explique ma vie ! Quand je pensais que j’étais à moitié autiste parce que je lisais des descriptions de l’autisme à moitié mal écrites.
En continuant à me documenter sur l’autisme, j’ai constaté que je ne me reconnaissais pas dans beaucoup de ses traits stéréotypés. J’ai commencé à penser que je pouvais être « à moitié autiste », parce que je n’évitais pas le contact visuel et je n’avais pas un visage ou une voix sans expression. Je n’avais pas d’intérêts restreints, aussi appelés « intérêts spécifiques ». Je ne bougeais pas de manière inhabituelle, ce qu’on appelle aussi le stimming.
Peu à peu, j’en suis venu·e à comprendre que je devais être pleinement autiste. Quelle découverte majeure ! Cela expliquait presque tous les problèmes que j’avais rencontrés dans ma vie, ainsi que beaucoup de mes bizarreries et de mes talents. C’était comme découvrir pour la première fois que j’étais en réalité un elfe, une sirène ou une fée — et qu’en plus, il n’y avait rien de mal à ça, et qu’il existait d’autres personnes comme moi.
Je pensais que la communication était difficile parce que j’étais maladroit·e et agaçant·e. En réalité, c’est difficile parce que je mets un effort énorme à traiter et analyser les mots, tout en manquant les significations implicites dans les gestes et le ton.
J’ai aussi adoré sa clarification sur le mot autisme. Quasiment tous·tes les militant·es te diront qu’il faut rejeter la vision médicale de l’autisme, mais peu pensent à proposer deux mots différents :
Une de mes premières « introductions » à l’autisme a été un autocollant de pare-chocs qui disait : « Mon enfant autiste déchire — au sens familier comme kinesthésique ! »
[C’est intraduisible, c’est “my kid rocks” ce qui veut à la fois dire être cool et se balancer pour se rassurer comme le font certains autistes]
C’était exact, mais incomplet. Il m’a fallu du temps pour comprendre que, même si le rocking (se balancer) est une action visible, l’autisme lui-même est un état interne qui entraîne des actions différentes selon les personnes. Est-ce que ça a des effets externes ? Bien sûr — dans ma façon de bouger, de parler, de réagir et de positionner mon corps. Mais si tu enlevais tout cela, mon esprit resterait autistique. Peu importe comment je parais de l’extérieur, je serai toujours autistique à l’intérieur.
Cependant, c’est une manière relativement nouvelle de penser l’autisme. Historiquement, dans le DSM, l’autisme a été défini par une liste de comportements. En y regardant de plus près, la plupart de ces comportements sont en fait des traits qu’un certain type d’esprit manifeste sous stress. Je trouve utile d’avoir un mot pour ce type d’esprit, donc je suis heureux·se que de plus en plus de personnes commencent à utiliser le terme « autisme » pour désigner un neurotype avec un ensemble de prédispositions.
Dès la naissance, cela rend certaines choses plus agréables et d’autres plus difficiles. Cela rend une personne plus vulnérable à certains types de détresse, sans que ce soit une fatalité. Je trouve aussi utile d’avoir un mot pour décrire la façon dont ce neurotype particulier interagit avec les stresseurs.
Le DSM appelle ça « trouble du spectre de l’autisme » (TSA), mais je préfère dire « détresse autistique ». Cela varie dans le temps, selon l’environnement et l’intensité d’éventuelles conditions associées. Ainsi, une personne peut remplir les critères pour un diagnostic de TSA à certains moments de sa vie, mais pas à d’autres — tout en restant continuellement autistique.
Employer le mot « autisme » pour désigner à la fois un neurotype et sa réaction au stress a créé beaucoup de confusion, beaucoup de stigmatisation et beaucoup de manques de soutien. Les deux me décrivent pourtant avec justesse, mais quand je dis que je suis autiste, en général je parle de l’autisme comme d’un neurotype.
Amen.
Et ça commence à faire long pour un email donc je te propose de faire la suite demain.
Ou alors tu peux regarder la suite directement dans la vidéo :