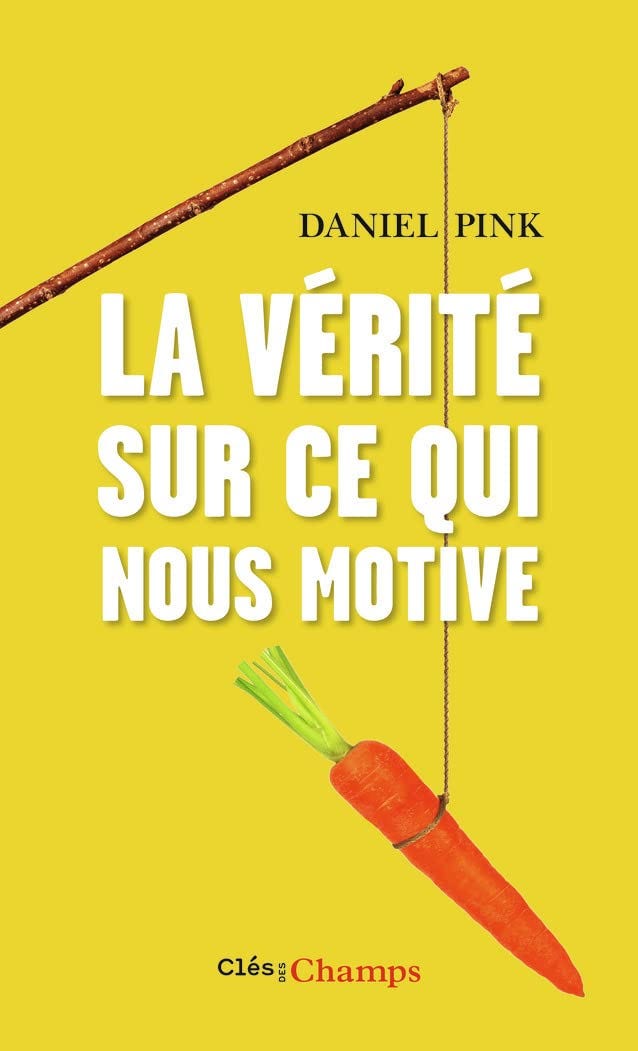Les 3 types de motivations
Hier je te parlais de 3 visions de la motivation. En réalité il s’agit de 3 types distincts de motivations.
La motivation de survie
La motivation extrinsèque
La motivation intrinsèque
On va s’intéresser particulièrement à l’opposition entre motivation extrinsèque et intrinsèque.
La motivation extrinsèque c’est facile à expliquer : c’est la carotte et le bâton. La punition et les récompenses.
La motivation est alors créée par quelque chose d’externe à soi.
Mais qu’est-ce que la motivation intrinsèque ?
La théorie de l’auto-détermination
La théorie de l’autodétermination (TAD) est fondée sur la notion de besoins humains universels. Selon cette théorie, nous avons trois besoins psychologiques innés : être compétent·es, être autonomes et entretenir des liens. Quand ces besoins sont satisfaits, nous sommes motivés, productifs et heureux. Quand ils sont contrecarrés, nous sommes contrarié·es et notre motivation et notre productivité s’en ressentent.
Au cours d’une de nos conversations, Ryan m’expliquait : « S’il est quelque chose [de fondamental] concernant notre nature, c’est notre capacité d’intérêt. Certaines choses la stimulent. Certaines choses l’inhibent. » Pour le dire autrement, nous avons tous ce troisième type de motivation. Cela fait partie de la nature humaine. Cependant, cet aspect de notre humanité ne peut apparaître que si des conditions favorables sont réunies.
On a donc trois leviers pour la motivation intrinsèque :
L’autonomie
La maîtrise d’une compétence
Le besoin d’appartenance à un groupe
Cette motivation intrinsèque est une source d’énergie extrêmement puissante. Sauf que… elle n’est pas compatible avec la carotte et le bâton.
Tu te rappelles des enfants qui dessinaient pour le plaisir et ce sont mis à moins le faire quand on a introduit des récompenses ? C’est parce que d’un coup on a fait basculer leur motivation de type 3 en motivation de type 2. Or, dans le contexte de tâches créatives, la motivation intrinsèque est beaucoup plus puissante qu’une motivation extrinsèque.
Individus de type I et individus de type X
Souvent quand je parle des découvertes sur la motivation on me dit : mais tout le monde n’est pas motivable par l‘autonomie !
C’est partiellement vrai. En effet on observe qu’il y a bien deux types de personnes.
Les personnes qui carburent à la motivation intrinsèque et qu’on appelle
personne de type I.Les personnes qui carburent à la motivation extrinsèque et qu’on appelle personne de type X
La bonne nouvelle c’est que ce n’est pas figé : n’importe qui peut devenir une personne de type I.
C’est donc vrai de dire que certaines personnes ne recherchent pas l’autonomie. En revanche c’est faux de le présenter comme une fatalité. Elles sont comme ça à cause des circonstances.
À coup sûr, en réduisant le comportement humain à deux catégories, on fait l’impasse sur un certain nombre de nuances. Personne ne se comporte constamment à 100 % selon le type X ou selon le type I.
Il n’en demeure pas moins, cependant, que nous présentons des tendances souvent évidentes. Vous comprenez sans doute ce que je veux dire. Songez à votre propre cas. Ce qui vous dynamise – ce qui vous permet de vous lever le matin et vous stimule durant la journée – provient-il de vous-même ou de l’extérieur ? Qu’en est-il de votre conjoint et de vos enfants, et de vos collègues ? Si vous êtes comme la plupart des gens que j’ai déjà rencontrés dans ma vie, vous avez sûrement une idée de la catégorie dans laquelle on peut classer telle ou telle personne.
Je ne veux pas dire que les personnes du type X passent toujours à côté du plaisir inhérent à leurs activités, ni que les personnes du type I sont réfractaires à toute forme de récompense extérieure. Cependant, chez les personnes du type X, les récompenses extérieures constituent le principal motivateur. Toute satisfaction plus profonde est la bienvenue, mais elle est secondaire.
Au contraire, chez les personnes du type I, ce sont la liberté, le défi et l’objet même de l’entreprise qui constituent le principal motivateur. Les autres profits sont les bienvenus, mais plutôt comme un avantage supplémentaire.
On le voit dans tous les domaines :
Les élèves qui étudient pour avoir des bonnes notes versus les élèves qui étudient pour le plaisir d’agrandir leurs connaissances
Les artistes qui produisent pour avoir un retour du public versus les artistes qui produisent pour l’épanouissement de la pratique
Les personnes qui travaillent pour l’argent versus les personnes qui aiment leur métier
Mais attention… ce n’est pas une fatalité. Les personnes sont en mode X parce que les circonstances le veulent. Ce n’est pas une tendance innée ou définitive. On peut changer.
Malheureusement… le mode X diminue les probabilités de réussites, dégrade la santé mentale et même… la santé physique !
Le rapport entre maladie cardiaque et type de motivation
Friedman, qui est mort en 2001 au bel âge de 90 ans, était cardiologue. Il a tenu pendant longtemps un cabinet à San Francisco. À la fin des années 1950, lui et son collègue, Ray Rosenman, ont commencé à remarquer des points communs chez leurs patients souffrant de maladies cardio-vasculaires. Leurs habitudes alimentaires et les gènes dont ils avaient hérité n’expliquaient pas tout. La façon dont ces personnes menaient leur vie comptait aussi.
Selon Friedman, ces patients présentaient : « Un regroupement particulier de traits de caractère, notamment une tendance excessive à la compétition, de l’agressivité, de l’impatience et le besoin irrépressible de se comporter comme s’ils étaient toujours dans l’urgence. Les individus qui présentent cette tendance semblent pris dans une lutte chronique, vaine et sans fin contre eux-mêmes, contre les autres, contre les circonstances, contre le temps et parfois contre la vie elle-même. »
Ces patients risquaient significativement plus de développer une maladie cardio-vasculaire, même par rapport à ceux qui présentaient des caractéristiques analogues en termes de physique, de sédentarité, d’habitudes alimentaires et d’antécédents familiaux.
Cherchant une formule pratique et facile à retenir pour expliquer cette idée à leurs collègues et au reste du monde, Friedman et Rosenman s’inspirèrent de l’alphabet. Ils nommèrent donc ce comportement le « type A ». Le comportement de type A s’oppose au comportement de type B. Friedman et Rosenman ont constaté que si les gens qui présentaient le comportement de type B vivaient leur vie bien plus calmement, ils étaient tout aussi intelligents et souvent aussi ambitieux que ceux de type A. Leur ambition se manifestait simplement autrement.
À propos de l’individu de type B (et avec cette manie typique de l’époque de privilégier le masculin), les deux cardiologues expliquent : « Il peut aussi présenter une force de motivation considérable, mais sa personnalité est telle que cela le stabilise et lui donne de la confiance et de l’assurance au lieu de l’aiguillonner, de l’irriter et de l’exaspérer comme cela se produit avec l’homme de type A. »
Les récompenses externes ont le même effet sur les singes
Ce que je trouve fascinant c’est que ces théories ont commencé par une étude sur des singes. On voulait étudier la motivation des singes en leur proposant du raisin en échange de la résolution de casse-tête.
Les chercheurs avaient placé les casse-tête dans les cages des singes pour observer la façon dont ils réagiraient et pour les préparer aux tests de résolution de problèmes auxquels ils seraient soumis au bout des deux semaines.
Or, presque tout de suite, il se produisit quelque chose d’étrange. Sans aucune pression extérieure ni incitation de la part des chercheurs, les singes se mirent à manipuler ces casse-tête avec beaucoup d’intérêt et semblèrent y trouver du plaisir. Il ne leur fallut pas longtemps pour assimiler le fonctionnement du système.
Au bout de deux semaines, ils étaient devenus experts en la matière et, deux fois sur trois, ils résolvaient le problème en moins d’une minute. Pourtant, personne n’avait jamais montré à ces singes comment retirer la tige, comment faire glisser le crochet ni comment soulever le couvercle. Personne ne les avait récompensés par de la nourriture ni par des gestes d’affection ou d’approbation.
Mais le plus fou ? Quand il a finalement introduit le raisin comme récompense, les choses ont empiré :
Pour répondre à cette question, Harlow proposa une nouvelle théorie, la théorie d'une troisième motivation: « La réussite de la tâche a constitué une récompense intrinsèque. » Les singes ont résolu les problèmes simplement parce qu'ils trouvaient gratifiant de les résoudre. Ils y ont pris du plaisir et le plaisir de le faire a été leur seule récompense.
Si cette idée était déjà révolutionnaire, ce qui est arrivé ensuite n'a fait qu'alimenter davantage encore la confusion et la controverse.
Cette motivation nouvellement découverte, que Harlow a par la suite appelée « motivation intrinsèque », était peut-être une réalité, mais il lui paraissait certain qu'elle était subordonnée aux deux autres.
Si l'on récompensait les singes, avec des raisins par exemple, ils feraient sans doute encore mieux. Or, il se passa le contraire : avec un système de récompense, les singes firent davantage d'erreurs et montrèrent moins d'intérêt pour la résolution des casse-tête.
Selon Harlow, l'introduction de nourriture dans l'expérimentation a eu pour effet de perturber la performance, un phénomène dont aucune étude n'avait fait état.
Les deux motivations se CONTREDISENT
C’est le point le plus important de ces recherches, ce qui a le plus bouleversé notre vision. Contrairement à ce qu’on pensait, les deux types de motivations ont énormément de mal à cohabiter. Parce que la punition/récompense va venir détruire le sentiment d’autonomie.
La carotte et le bâton détruisent la motivation intrinsèque par cet effet.
Le parallèle entre drogue et motivation extrinsèque
Les récompenses externes comme l’argent sont une drogue. Leur fonctionnement est similaire. En effet, quand on te propose de l’argent tu vis un pic de plaisir mais ça se dissipe. Ensuite il faut augmenter la dose pour que ça te fasse quelque chose.
C’est pour ça que si tu as une grosse augmentation au boulot tu vas te sentir en extase pendant 15 jours, peut-être 1 mois ou 6… mais en tout cas y’a un moment où ça redevient anodin.
Il est troublant de constater à quel point le cerveau réagit de la même façon, que l’on promette au sujet une rémunération ou qu’on lui donne de la cocaïne, de la nicotine ou des amphétamines.
Quand une personne s’enflamme parce qu’elle espère une récompense, cela ne l’incite pas à prendre de meilleures décisions comme Motivation 2.0 le suppose. Elle est plutôt susceptible d’en prendre de pires.
En d’autres termes, carburer à la récompense fonctionne mais ça nous crame. C’est une énergie de type fossile. Alors que la motivation intrinsèque (autonomie/compétence/appartenance) va nous faire avancer sans nous cramer. Au contraire, elle va même élever notre bien-être. C’est une énergie renouvelable.
Heureusement, il n’y a pas de fatalité, même si nous n’avons pas les mêmes conditions. Plus tu es dans un environnement qui te tient par la menace de la perte de ton salaire et moins ce sera facile de trouver ta motivation intrinsèque.
Mais la première étape pour y arriver c’est de comprendre chacune des trois composantes de cette motivation.
On en reparle demain.
Source
Toujours le livre de Daniel Pink qui lui-même s’inspire des travaux de Deci et Ryan.
: