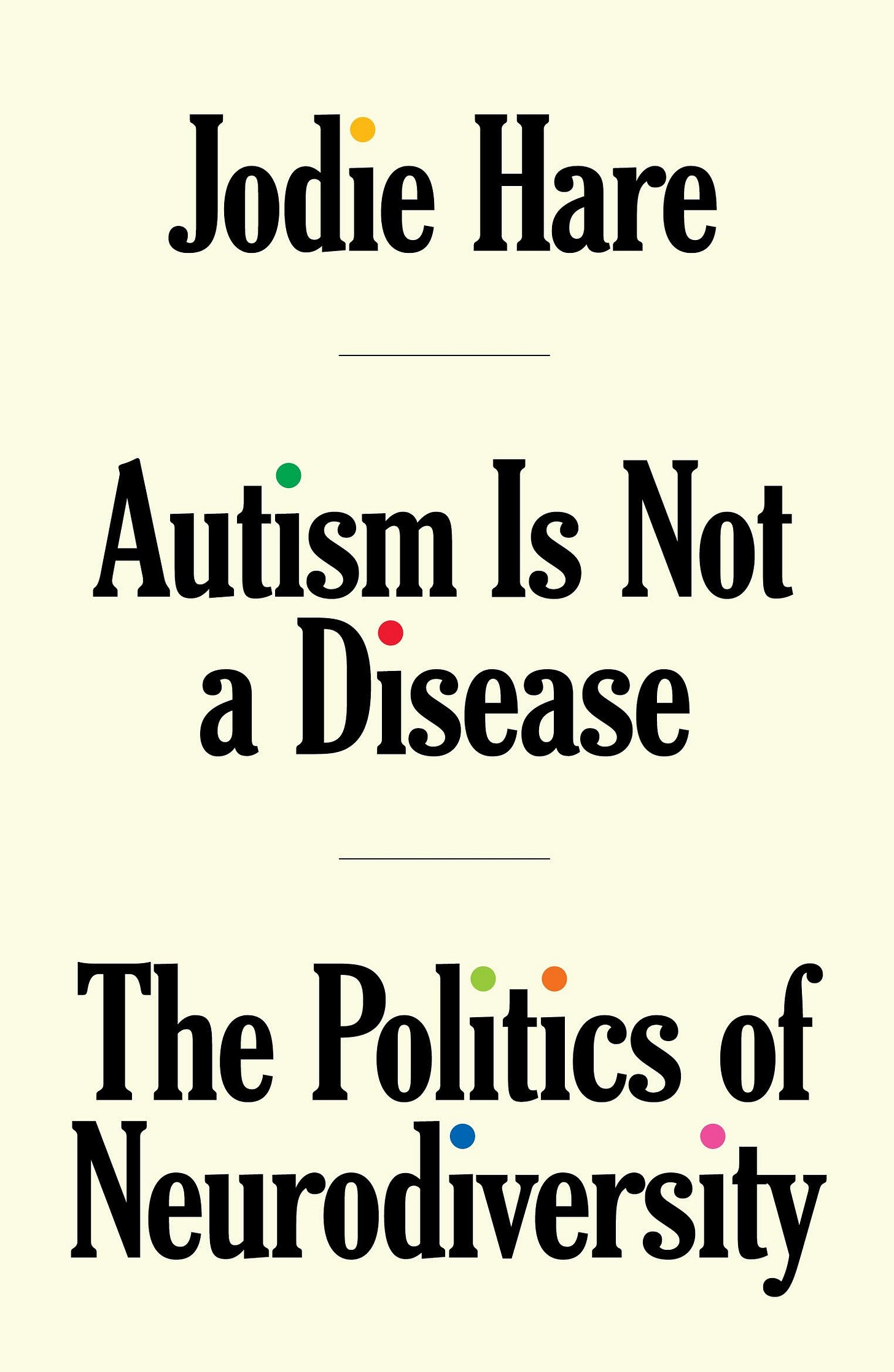La neurodiversité est MILITANTE ou n'est pas
Jeudi à 12h30 j’organise un atelier d’auto-identification autistique. L’idée c’est de se bloquer du temps pour faire ensemble des auto-tests d’identification de l’autisme. Si tu n’as jamais pris le temps de les faire et que tu te sens concerné·e c’est le moment. Si tu sais déjà que tu es autiste mais que tu as un·e proche qui se demande… partage lui. Le lien pour s’inscrire est ici (il n’y aura pas de replay, mais je te mets une file d’attente pour un éventuel prochain si tu n’es pas dispo à cette date) : https://nicolasgalita.podia.com/workshop-es-tu-autiste
Beaucoup de gens ignorent ce qu’est le mouvement de la neurodiversité. Parce qu’ils croient que ça veut dire tous les cerveaux sont différents. Idem pour neuroatypie. J’ai au moins 5 personnes qui m’ont dit récemment une variante de je pense être neuroatypique mais je sais pas quoi. Mais quand je leur cite toutes les neuroatypies possibles elles me disent que non.
Ça ne marche pas comme ça.
Ce serait comme dire je me sens LGBTQIA+ et quand je te demande à quoi tu t’identifies tu me réponds à rien.
Le mouvement de la neurodiversité est un mouvement militant qui visent à abattre un ennemi. Ce n’est pas une manière plus cool de dire “autisme” ou “TDAH”.
Autism is not a disease - Jodie Hare
Cette semaine je vais te résumer le livre Autism is not a disease de Jodie Hare
Ce livre a été une vraie claque pour moi. Il m’a permis de comprendre pleinement ce mouvement militant.
Donc cette semaine, tout ce que je vais dire va être une paraphrase de ce livre.
On commence par le commencement
D’où vient le mouvement de la neurodiversité ?
Ce mouvement est issu des militant·es autistes :
Bien que le concept ait été formulé à l’origine en pensant aux autistes, on considère désormais que la neurodiversité inclut aussi :
le TDAH
la dyslexie
la dyscalculie
la dyspraxie
les troubles des apprentissages
les affections neurologiques acquises (comme un traumatisme crânien)
le syndrome de Down (trisomie 21)
la schizophrénie
la démence
la maladie de Parkinson
les troubles psychiques de longue durée, tels que le trouble bipolaire
Ce qui rend ces diagnostics significatifs, c’est leur capacité à façonner l’identité profonde d’une personne.
Contrairement à des affections temporaires ou curables, celles-ci influencent la façon dont une personne interprète le monde qui l’entoure, traite les informations extérieures et existe dans le monde.
Une citation souvent reprise de Jim Sinclair, l’un des membres fondateurs du Autism Network International, dit ceci :
“L’autisme n’est pas quelque chose qu’une personne a, ni une “coquille” dans laquelle elle serait enfermée. Il n’y a pas d’enfant “normal” caché derrière l’autisme.
L’autisme est une manière d’être. Il est omniprésent : il colore chaque expérience, chaque sensation, chaque perception, chaque pensée, chaque émotion et chaque rencontre — chaque aspect de l’existence. Il est impossible de séparer l’autisme de la personne — et si cela était possible, la personne restante ne serait plus la même que celle du départ.”
Mais surtout, le mouvement de la neurodiversité a émergé pour lutter contre un ennemi. La neurodiversité postule qu’elle constitue une catégorie opprimée pour laquelle elle lutte. De la même manière que le féminisme lutte contre le patriarcat, le racisme contre la suprématie blanche, la neurodiversité lutte contre le validisme.
Elle est donc une branche de l’antivalidisme. L’antivalidisme c’est la lutte pour les droits des personnes handicapées.
Corollaire : les personnes neurodivergentes sont donc vues comme handicapées.
Les gens qui utilisent le mot neurodivergent·e comme euphémisme pour éviter de dire handicapé·e sont donc en train de trahir l’esprit du mouvement.
C’est important parce que parfois on nous dit ouais mais attendez les militants de la neurodiversité, vous minimisez les difficultés qu’on peut vivre en étant autiste.
Bah… pas du tout ? Dire que ce n’est pas une maladie mais bien un handicap ne dit rien de la difficulté. Ce qu’on dit c’est que ça ne se guérit pas, ça n’est pas un virus mental. Mais aussi que le handicap, contrairement à la maladie est forcément contextuel.
L’ennemi : le modèle médical du handicap
Le paradigme de la pathologie repose en fin de compte sur deux postulats fondamentaux :
Il existerait une seule manière “juste”, “normale” ou “saine” pour un cerveau ou un esprit humain d’être configuré et de fonctionner (ou, au mieux, une plage relativement étroite de “normalité” dans laquelle la configuration et le fonctionnement des cerveaux et des esprits humains devraient s’inscrire).
Si ta configuration neurologique et ton mode de fonctionnement — et donc, par conséquent, ta manière de penser et de te comporter — s’écartent de manière significative de la norme dominante du “normal”, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez toi.
Mais surtout : toute personne déviant de la neuronorme est malade et on doit la guérir. Pire encore ta vie vaut un peu moins la peine d’être vécu si tu n’est pas dans la neuronorme.
À l’inverse, les militants de la neurodiversité croient qu’il faut introduire le modèle social du handicap.
Le modèle médical suggère que la personne en fauteuil roulant est celle qui a un problème, et qu’elle devrait tout faire pour retrouver sa mobilité.
Le modèle social, au contraire, propose que la véritable solution consiste à installer une rampe ou à modifier l’environnement bâti de façon à garantir l’accessibilité.
Si, demain, tu te retrouvais téléporté·e dans une société où les gens ont des ailes : tu serais immédiatement handicapé·e. Parce que le handicap est forcément contextuel. Dans une telle société, il n’y aurait probablement pas de barrières aux balcons ou sur les ponts. Dans les montagnes y’aurait pas de téléphérique parce que ça ne servirait à rien.
Ton handicap provient donc du fait que la société ne s’adapte pas à tes besoins à toi.
Alors… est-ce que, comme je l’ai entendu : y’a des militant·es qui disent que l’autisme n’est QUE une différence et jamais négatif en soi.
Oui.
Mais c’est trop facile de résumer tout le mouvement à elleux.
Il y a des variations dans le mouvement
Comme dans tous les mouvements politiques, il y a plusieurs branches au sein du même mouvement. La variation se fait principalement autour du dosage entre le handicap vient de la personne / le handicap vient de la société.
Aucun·e militant·e de la neurodiversité ne croit que le handicap provient uniquement de la personne.
Par exemple, à titre personnel, je dirais que je crois que c’est 15% la personne - 85% la société.
Oui, y’a des militant·es qui croient que c’est 0% la personne - 100% la société.
Le point commun des membres de ce mouvement c’est le fait de s’opposer à la vision 100% la personne - 0% la société (la vision médicale).
Comme le souligne Dwyer, il reste possible que, même si toutes les barrières de la société étaient levées, les personnes handicapées continueraient à rencontrer certaines difficultés propres à leur fonctionnement. Il donne par exemple celui de quelqu’un qui a des difficultés de fonctions exécutives : même avec l’accès à des applications de planification et à diverses mesures d’aménagement, cette personne pourrait toujours éprouver des difficultés à gérer son temps.
Moi, par exemple, je vois bien que même si le monde avait été construit par d’autres autistes, je continuerai à avoir des soucis à m’endormir et des bruits qui me crispent. Y’a effectivement une partie incompressible.
Mais, une chose est sûre : une grande partie provient de la société.
Le lien aux autres luttes
Une fois qu’on comprend l’ennemi, qu’on comprend que c’est une lutte pour l’égalité, on comprend également qu’elle doit s’articuler avec les autres luttes. C’est ce qu’on appelle l’intersectionnalité.
Cette lecture permet deux choses :
Comprendre qu’on ne peut pas être antivalidiste sans essayer en même temps de lutter contre le racisme, le sexisme, l’homophobie, la transphobie, l’antisémitisme, etc
Comprendre qu’au sein même de notre mouvement il y aura ces dynamiques
Par exemple, il y a malheureusement beaucoup de militant·es autistes de la première heure qui sont ouvertement misogynes. Parce qu’ils refusent d’accepter qu’une femme puisse être autiste.
De même, les personnes racisées vont moins souvent être reconnues autistes que les autres. Et ainsi de suite.
Le diagnostic est l’arme ultime de nos ENNEMIS
J’avais déjà cette intuition mais le livre m’a permis d’identifier clairement pourquoi je hais à ce point la démarche diagnostique quand on parle d’autisme.
Le système validiste nous dit : moi je considère que c’est une maladie donc on va diagnostiquer et seul·es des médecins pourront le faire.
Ça n’a aucun sens. Ce n’est pas aux médecins de dire qui vit l’oppression autistophobe. Car ce qui unit les autistes c’est avant tout l’oppression subie.
De la même manière que le racisme est la chose qui unit les personnes racisées : nous sommes racisé·es parce que des blancs nous voient comme tel·les et appliquent la grille raciste sur nous.
Les militant·es de la transidentité font face au même obstacle : un médecin doit valider que tu es bien trans si tu veux pouvoir transitionner. Mais c’est insensé : les médecins n’y connaissent rien. Si bien que beaucoup de personnes racontent qu’elles ont dû jouer le stéréotype de ce que le médecin imagine être une personne trans pour avoir le tampon du médecin.
On marche sur la tête.
Le diagnostic fait partie de ce qui permet au modèle médical de prospérer : il fonctionne comme le principal moteur de la pathologisation.
Attribuer un diagnostic à une personne neurodivergente peut lui permettre d’accéder à une petite quantité de ressources publiques, mais cela l’expose également à un risque de mauvais traitements et de discrimination.
Le mouvement de la neurodiversité existe en opposition à cette pathologisation médicale et à l’idée qu’il existerait des cerveaux « normaux » et « non normaux ».
Cela signifie qu’un objectif essentiel de la neurodiversité est d’éliminer le besoin de tels diagnostics, de retirer au modèle médical son pouvoir.
Aujourd’hui, la survie de nombreuses personnes neurodivergentes dépend de ces diagnostics – mais cela ne veut pas dire que nous devrions l’accepter comme un état de fait, ni que nous ne pouvons pas imaginer autre chose.
(…)
En reliant le travail du mouvement pour la neurodiversité à d’autres mouvements de libération, nous pouvons créer un monde dans lequel, chaque fois que nécessaire, toute personne pourrait accéder aux soins dont elle a besoin.
En réponse à ce besoin, les ressources seraient automatiquement mises à disposition de cette personne ; et l’accès à ces ressources ne serait pas déterminé par la richesse, l’âge, le lieu, le genre, la sexualité, la race, un accès préalable à des soins ou tout autre facteur qui détermine aujourd’hui la possibilité d’obtenir une aide adéquate.
Personne ne serait freiné·e dans sa volonté d’obtenir des soins par la perspective de subir du validisme, de mauvais traitements ou de la discrimination.
Dans un monde doté de tels systèmes de soins, la pathologisation serait-elle encore nécessaire ?
Pouvons-nous imaginer un monde sans ces diagnostics ?
Il est tout à fait possible qu’une partie de ce langage demeure, afin d’expliquer l’expérience d’une personne dans le monde, d’aider à communiquer ce que cela fait de vivre dans tel ou tel corps.
Mais on peut espérer qu’un monde construit au service de la libération de toutes et tous ne nous obligerait plus à continuer de donner du pouvoir à des systèmes qui cherchent à nous déshumaniser, à nous contrôler, et dans bien des cas, à nous détruire.
Quelque chose de nouveau peut émerger.
Source
Tous les extraits viennent de Autism is not a Disease de Jodie Hare.